Nature de l’intuition
« L’intuition est un pouvoir propre à l’homme qui le rend capable d’une expérience pure. » L. Bergson
« L’intuition est un pouvoir propre à l’homme qui le rend capable d’une expérience pure », écrivait Bergson. Einstein disait que l’intuition est un don sacré de l’Homme, et que la raison doit être à son service alors que bien souvent nous sommes dans l’adoration du serviteur. L’intuition est cette source d’inspiration à l’origine de tous les grands progrès humains, de toutes les créations, de toutes les découvertes. Chacun en fait l’expérience, quotidiennement ou dans des moments particuliers, sous forme d’un « sixième sens » qui nous sert de boussole dans les décisions les plus ordinaires, nous révèle des vérités profondes ou nous avertit de grands dangers.
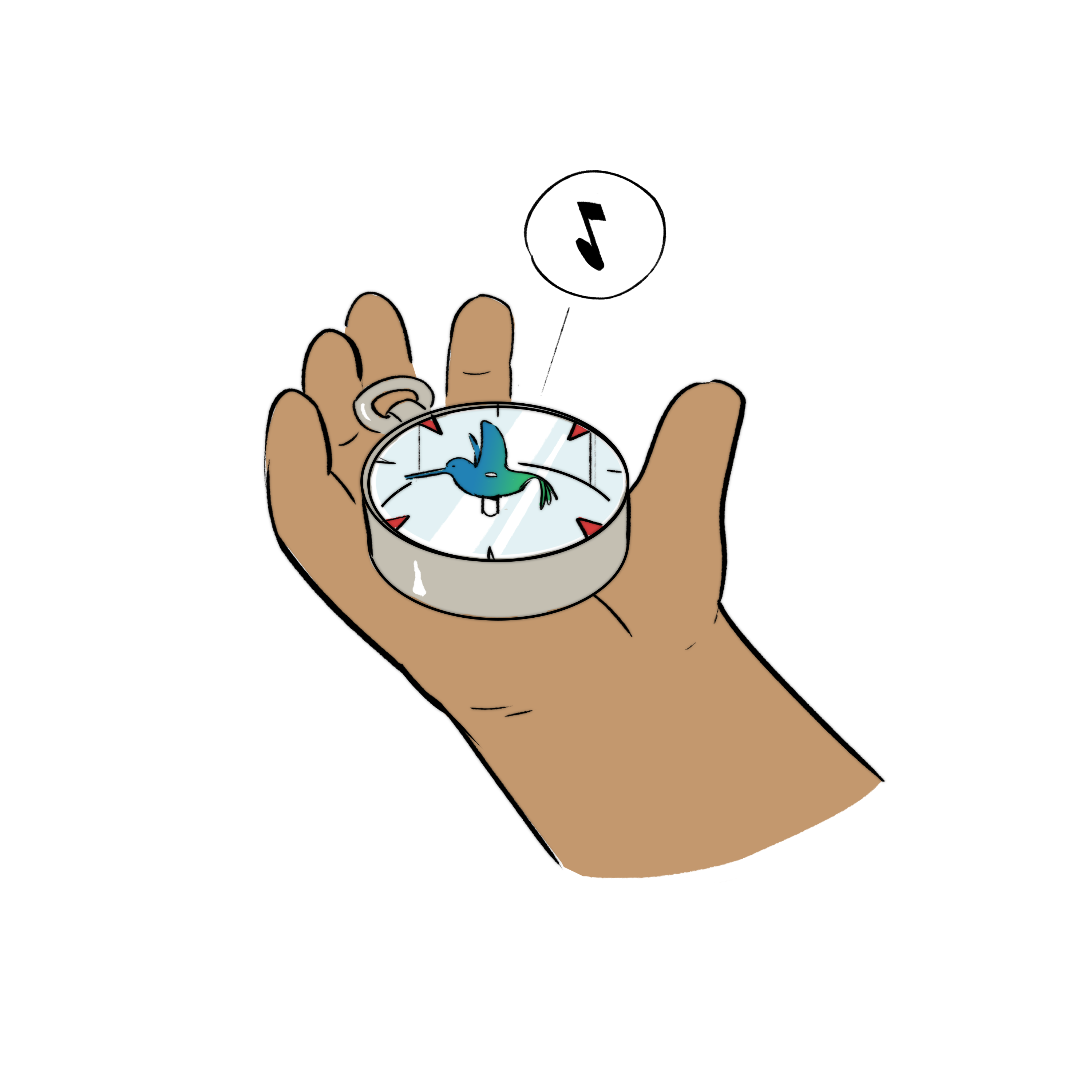

Mais qu’est-elle exactement ? Et comment fonctionne-t-elle ?
La notion d’intuition – dont la racine latine peut aussi bien être intueor, « regarder avec attention », que intuitio, « réflexion dans un miroir » – renvoie à l’idée ancienne en philosophie que certaines de nos connaissances sont des données immédiates et premières. Elles précèdent les connaissances qui découlent des sens ou d’un raisonnement. C’est une des règles de base de la théorie de la connaissance de Descartes : la connaissance intuitive prime sur les autres. Elle n’est pas explicable et pas négociable. Et par définition elle n’est pas rationnelle. Notre certitude d’exister, par exemple, est une intuition de base.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, c’est au tour d’un autre grand psychiatre, l’Américain Eric Berne, père de l’analyse transactionnelle, de s’intéresser à l’intuition, qui renseigne d’instinct le thérapeute sur son patient et sous-tend ses jugements. Berne opère un distinguo entre plusieurs sortes d’intuitions : certaines peuvent s’expliquer par des indices subliminaux, des compétences devenues des réflexes, des raisonnements automatisés, non verbalisables ou inconscients ; mais certains flashs intuitifs n’appartiennent pas à cette catégorie : ni la communication non verbale, ni l’expérience, ni la déduction ne peuvent les expliquer. Il fait plusieurs observations : ces certitudes intuitives viennent dans un état psychologique particulier entre attention vigilante et lâcher-prise du mental (Descartes définissait l’intuition comme la conception ferme d’un esprit pur et attentif). Chacun possède cette aptitude et peut la développer avec de la pratique. Enfin, cette sorte d’intuition est plus efficace quand on ne sait rien de la personne en face de soi ou de la question ciblée. Il associe cette forme d’intuition à ce que son confrère Joseph Banks Rhine étudie expérimentalement depuis une dizaine d’années, sous une autre appellation (Berne 1977).
Depuis le début des années 30, Rhine, professeur de psychologie à l’université de Duke, a mis au point une méthode pour étudier en laboratoire certaines facultés controversées de l’esprit humain, comme celle d’acquérir de l’information sur une chose, un événement ou une personne sans la médiation des sens physiques ou d’un raisonnement. En d’autres termes, il cherche à étudier scientifiquement la télépathie, la clairvoyance, la prémonition – qu’il rassemble sous le terme générique de « perception extrasensorielle » (ESP). C’est donc par définition de la perception intuitive, dont il teste différentes facettes chez de nombreux volontaires (des étudiants) en leur faisant « deviner » une cible (la face d’un dé, un symbole, la couleur d’une carte à jouer) et en répétant cette opération un nombre de fois (Rhine 1940).
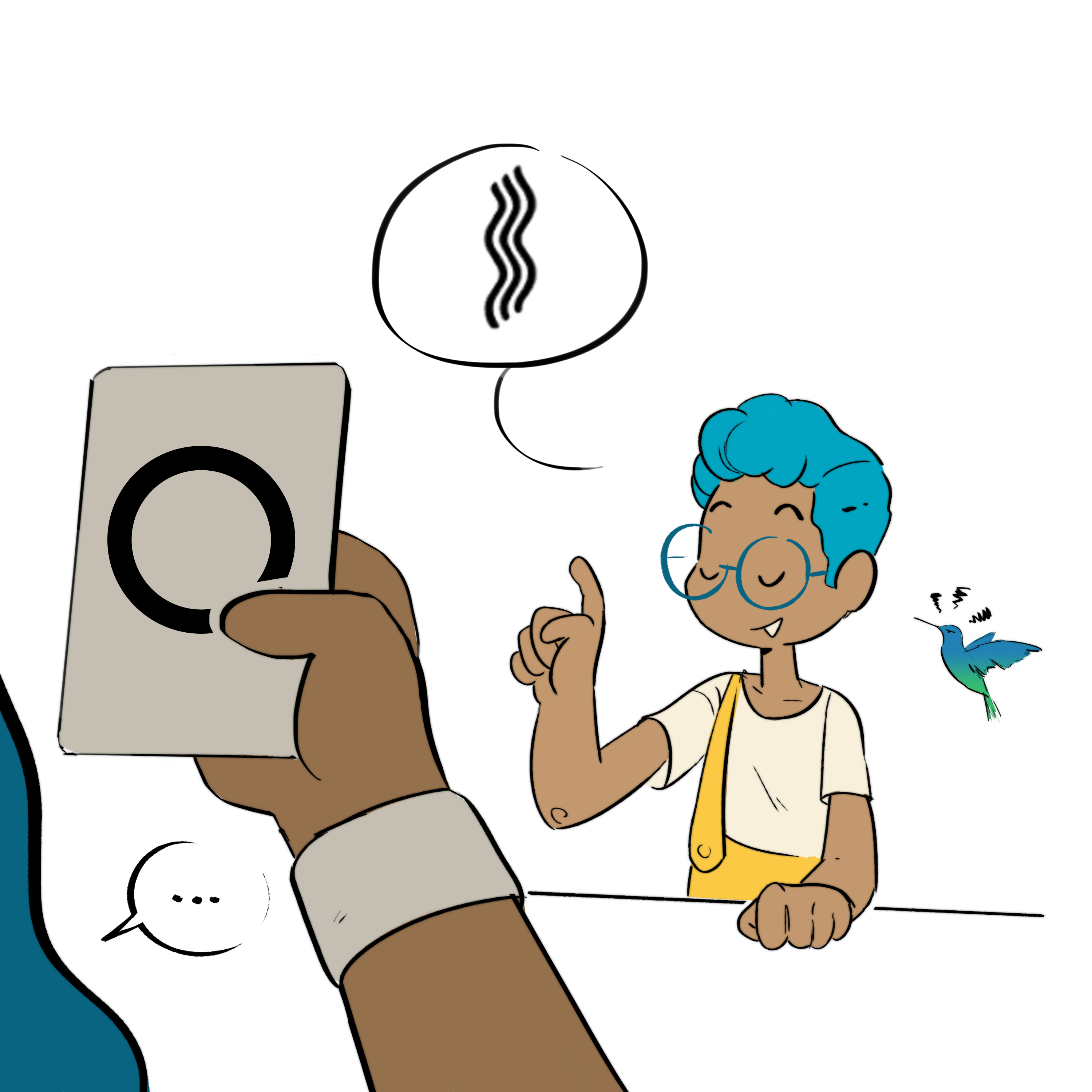
L’avantage de ce type d’expériences est qu’elles sont facilement reproductibles et permettent de faire des calculs statistiques, sur un grand nombre de tests, d’études, de participants. Ce type d’expériences et l’analyse de leurs données ont permis d’étudier les manifestations intuitives (et d’autres phénomènes qui leur sont liés), qui sont par nature non reproductibles, rarement spectaculaires, et idiosyncratiques (variables d’une personne à l’autre), comme n’importe quel effet étudié en sciences humaines, en psychologie, en médecine ou en pharmacologie.
Au cours des décennies ces expériences ont été refaites par des dizaines de chercheurs, parfois avec des innovations et des variantes, comme l’arrivée de l’ordinateur pour sélectionner les cibles à chaque essai et automatiser les tests, ou le recours à internet pour proposer des tests en ligne et acquérir d’énormes volumes de données (Radin 2019).
Les conclusions de ces études, rassemblées dans des méta-analyses, confortent amplement les observations empiriques de Jung, Berne ou Rhine : les êtres humains perçoivent des informations auxquelles ils n’ont pas accès sensoriellement, statistiquement mieux que s’ils devinaient au hasard (Bem et al. 2016, Storm & Tressoldi 2023). L’écart entre la performance humaine et le hasard n’est souvent pas spectaculaire (il l’est parfois, pour quelques rares individus), et personne ne peut dire, pour tel essai couronné de succès, s’il a été le fruit de l’intuition ou d’un « coup de bol ». Mais ce qui importe est que l’écart ne disparaît pas quand le nombre d’essais devient très grand, il tend au contraire vers une certaine valeur, et sa probabilité d’être un effet réel, et pas un résultat fortuit, devient astronomiquement grand.

La même méthodologie a été appliquée à d’autres types d’expériences de laboratoire sur l’intuition, comme la méthode ganzfeld, très utilisée pour étudier la télépathie autour des années 60 et 70. (La télépathie peut être conçue comme une intuition informant un sujet de ce qui se passe, émotionnellement ou mentalement, chez une autre personne.)
Mentionnons un autre type d’expériences sur l’intuition, dites « à questions ouvertes » (free response). Ce sont des expériences où la personne est chargée de percevoir intuitivement une cible, et laissée libre de la décrire comme elle le veut, sans contrainte. Ces expériences ont donné d’excellents résultats, peut-être que l’aspect plus libre du protocole le rend plus motivant.
Grâce à ces protocoles expérimentaux les chercheurs ont exploré les facteurs psychologiques (croyances, traits de caractère, attitudes) et les états de conscience (relaxation, transe, hypnose, flow…) (Honorton et al. 1971, Braud 1975, Rao et al. 1978, Alvarado 1998, Roney-Dougal & Solfvin 2006) qui favorisent la manifestation de nos facultés intuitives.
L’intuition mesurée dans ces expériences est avérée, globalement reproductible et statistiquement significative, mais contrairement aux cas spontanés où l’intuition surgit dans notre quotidien, elle est assez peu remarquable pour la majorité des gens sauf si certaines conditions expérimentales ou de préparation psychologique sont réunies. Les variations de performance intuitive entre individus sont importantes, et les « modérateurs » permettant de prédire de bonnes performances chez les uns et les autres ont été abondamment étudiés.
Quant au fait que la « taille d’effet » moyenne des phénomènes étudiés, prend toujours une certaine valeur, faible, dans tel ou tel protocole expérimental, c’est en soi une question d’un grand intérêt. Cette caractéristique d’extrême discrétion, voire de camouflage et d’élusivité, laisse supposer que la connaissance intuitive est rarement conscientisée et opère, à la racine de nos comportements et de nos prises de décision les plus anodins, en mode subliminal. Plusieurs psychologues ont proposé des théories de l’intuition de cette sorte (par ex. Stanford 1974). Elles ne sont pas sans rappeler les idées sur l’intuition et l’inconscient de Jung ou du pionnier de la psychologie expérimentale, William James.
Les premières études scientifiques modernes de l’intuition ont donc été le fait de psychologues expérimentaux, voulant comprendre le fonctionnement de la pensée humaine. Mais assez vite, des physiciens se sont joints à ces recherches : ils ont vu dans les manifestations de l’intuition des paradoxes passionnants et des résultats empiriques potentiellement riches en enseignement sur le temps, la réalité physique, la nature de la conscience, et ce qui les relie.
Pour les mêmes raisons, une autre (grande) partie des physiciens rejette d’emblée ces phénomènes qui bousculent une vision du monde autour de laquelle le paradigme actuel de la physique s’est bâti, notamment les principes de causalité, de localité, ou de réalisme.
L’intuition suppose en effet qu’une information peut parvenir à l’esprit d’un individu sans transiter par des voies sensorielles ou énergétiques, contrairement à tous les processus que la physique comprend et modélise. De plus, l’intuition ne semble pas dépendre de la distance et du temps : dans un test de choix forcé, la cible peut se trouver arbitrairement loin du sujet, et même dans son futur s’il s’agit d’un test de précognition. L’intuition est donc une perception non locale.
Le concept de localité, hérité de la physique classique, affirme qu’une information ne peut être transmise entre un point A et un point B que si ces points sont mis en contact, soit directement, soit par l’entremise d’un ou plusieurs messagers – des ondes, des particules élémentaires, des champs. L’intuition a-t-elle un messager ?
Toutes les tentatives d’appliquer à l’intuition des concepts purement physiques (des processus impliquant matière ou énergie) ont échoué. L’intuition ne semble pas avoir de tels messagers, et fonctionne selon d’autres lois. Certains physiciens pensent qu’il est plus prometteur de l’aborder sous l’angle de principes informationnels comme la néguentropie ou l’intrication quantique (Costa de Beauregard 1985,von Lucadou & Kornwachs 1985, Stapp 1996).
Par ailleurs, l’intuition fait forcément appel à quelque chose que chez les humains nous appelons le psychisme – sans une forme d’esprit ou de conscience pour faire l’expérience de l’intuition, fut-elle subliminale, l’expérience intuitive n’existerait pas. Nous ne pouvons statuer sur la réalité de l’intuition chez d’autres espèces vivantes, pas mieux que sur leur intelligence ou leurs émotions, car de leur expérience subjective nous n’avons qu’une connaissance très indirecte. Mais dans le cas humain, nous savons que pour pouvoir parler d’intuition il faut inclure la dimension de la psyché – en termes philosophiques, une réalité subjective, un monde 2 de Popper, des qualia. Aucune science exclusivement matérialiste, ou qui ne prendrait pas en compte cet aspect ontologique de l’expérience, ne saurait comprendre et expliquer l’intuition.
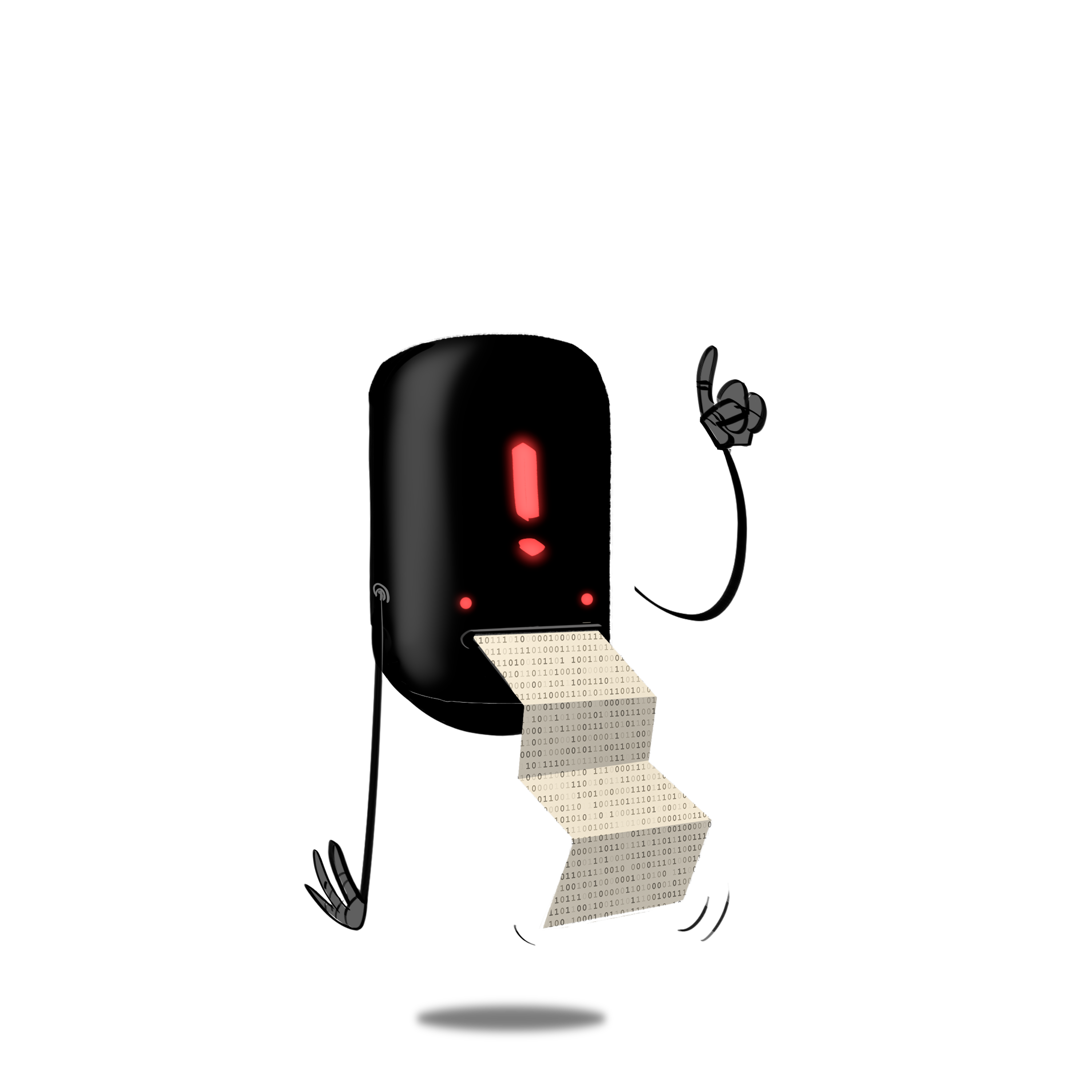
Ils sont d’un autre avis…
Pour certains psychologues et neurobiologistes, l’intuition n’a rien à voir avec la perception extrasensorielle – soit que celle-ci leur semble par principe impossible, soit qu’il n’y ait nul besoin, selon eux, d’y faire appel pour expliquer l’intuition. Ce que nous appelons intuition ou instinct ne serait alors qu’une remarquable aptitude à raisonner inconsciemment ; même l’intuition prémonitoire résulterait d’une faculté d’anticiper à partir de données connues ou probables. Ces raisonnements utiliseraient des informations subliminales, un vécu intériorisé (une sorte de deep learning), et une algorithmie du cerveau ultrarapide court-circuitant la pensée consciente. On pourrait identifier cette faculté au « système de pensée 1 » de la théorie de Kahneman – par opposition au « système 2 » qui est la pensée lente, consciente et contrôlée (Kahneman 2012). Des processus mentaux inconscients de cette sorte, déjà envisagés par Berne, Jung, James, peuvent certes expliquer certains faits qu’on range communément dans la catégorie « instinct / intuition » ; mais pourraient-ils expliquer aussi les connaissances intuitives obtenues en aveugle et défiant la causalité ? Pourraient-ils expliquer les anomalies statistiques mesurées dans les expériences de choix forcé ? Rien ne semble moins sûr.

